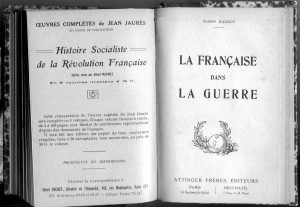« Il reste de la ménagère dans la tourneuse d’obus et les femmes font de la métallurgie comme du tricot. »
« Or, ces sombres et rudes combattantes, d’où viennent -elles? Dans la région lyonnaise, sur 2.000 femmes employées par une usine de guerre, on a compté 400 culottières, 400 femmes de ménage, 200 giletières, 150 couturières, 150 lingères, 4 artistes. A la Pyrotechnie de Saint-Chamond, 2.000 femmes du pays se sont enrôlées, qui n’avaient jamais manié que l’aiguille ou le balai et l’on n’a pas oublié les doléances de toute la bourgeoisie qui ne peut plus recruter de bonnes. — « Madame, je m’en vais aux munitions ! » »
« Ne semble-t-il pas y avoir, en effet, une incompatibilité nécessaire entre la maternité et le travail, entre les nécessités de la grossesse ou de l’allaitement et les exigences, les fatigues de l’atelier ? Comment concilier ces contraires ? »
Quelques extraits de la brochure de Gaston Rageot, La Française dans la Guerre, reproduite ci-dessous:
INTRODUCTION
L’Avènement de la Femme à la vie nationale
Parmi toutes les nouveautés que cette guerre, désorganisant le vieux monde pour en faire un meilleur, aura provoquées, la plus saisissante peut-être et la plus durable aura été fournie par l’avènement de la Femme à la vie nationale.
En 1870, les femmes avaient joué un rôle excessivement effacé, non parce qu’elles ne voulaient pas travailler, mais parce qu’elles ne le pouvaient pas. « Leur instruction rudimentaire — témoigne une femme d’intelligence et de cœur, Mme Siegfried, — l’habitude qu’elles avaient prise de se taire dans leurs familles, lorsque des discussions d’ordre politique ou religieux éclataient, l’aumône qui était dans ce temps-là la seule préoccupation philanthropique des femmes de bien, tout cela ne les préparait pas à jouer pendant la guerre un rôle bien prépondérant. Leur cœur de femme, de mère, d’amie, souffrit profondément. »
Temps reculés, et mœurs lointaines : temps et mœurs d’ancien régime.
Peu d’hommes, alors, partaient a l’armée et un grand nombre de familles restaient indemnes. Aujourd’hui, toute la France masculine combat : il a donc fallu que toute la France féminine travaillât. Le vieux mot ridicule est devenu sublime : « la remplaçante », on l’a vue partout, — aux champs, à l’usine, au bureau, à la boutique et au comptoir : on l’avait vue tout de suite à l’hôpital, on aurait pu la voir à la tranchée : on l’a vue, jusque sous le canon, à la charrue ou au métier.
Le 24 septembre 1916, la Commission Industrielle Américaine visitait Saint-Chamond.
Marteau-pilon de soixante tonnes, laminoirs gigantesques, aciers rouges ou blancs étincelant sous les pieds et sur les têtes, coulées de métal en fusion – toute l’horreur magnifique de la guerre industrielle devenue tableau de cinéma. Au milieu, mêlées aux hommes et aux flammes, des jeunes femmes graves, vêtues de cuir, sculpturales. Les machines qu’elles dirigent travaillent comme celles des hommes, mais d’un rythme plus régulier, semble-t-il, plus continu, à cause de la douceur de leurs mouvements et de leur vigilance. Il reste de la ménagère dans la tourneuse d’obus et les femmes font de la métallurgie comme du tricot. Il y en avait une au haut d’une tour de fer, forte, belle, qui, se pliant et se redressant, puis se penchant de côté, accomplissait implacablement son doux travail. Tous les yeux des Américain s’étaient fixés sur elle, qui ne les voyait pas. L’un des visiteurs étrangers dit : « Votre semeuse est belle sur vos timbres et sur votre monnaie. Mais cette femme est encore plus belle. Elle est une statue qui incarne l’heure présente, la femme non plus seulement agricole, mais industrielle, la femme nourrissant d’acier ceux du front, la femme égale à l’homme dans le travail viril, la Française de 1916, la France de 1916 (1). » [(1) Rapport de la Commission Industrielle Américaine en France (septembre-octobre 1916)]
Le Symbole, ce n’est pas nous qui l’avons cherché : ce sont nos grands alliés, — nos amis alors — qui l’ont trouvé ! !…
Quand un sculpteur de génie, sur l’arc de triomphe de l’avenir, voudra figurer sur la pierre la victoire du monde, il y dressera ce diptyque : un grand soldat de France, portant la capote et le casque, et, à côté de lui, inclinée et frémissante, lui offrant, non pas des lauriers, non pas des fleurs, mais un fruit de guerre, — la grenade. — une petite femme en bonnet d’usine. La victoire des Alliés aura été la victoire de la femme française.
L’Initiative féministe
Lorsque l’Allemagne s’est jetée sur la France, en août 1914, la France ne s’attendait pas à être attaquée. Cette surprise ne l’a pas déconcertée : elle y a répondu par l’unanimité de sa mobilisation. Elle ne s’attendait pas davantage à la nature de l’attaque qui était dirigée contre elle et n’avait prévu ni la variété, ni la puissance d’un armement auquel un peuple entier avait consacré, depuis un demi-siècle, son génie meurtrier.
Cette seconde surprise ne l’a pas ébranlée non plus : elle y a répondu en opposant l’homme à l’engin, le combattant à la mécanique, la vaillance à l’industrie, et toute la machinerie allemande est venue se briser sur les poitrines françaises : la Marne fut la victoire du soldat.
Cet élan, qui soulevait nos héros, emporta aussi le cœur des femmes. Elles les avaient vus partir, ceux qu’elles aimaient plus qu’elles-mêmes, dans l’allégresse et les fleurs, puis revenir sanglants et sales, reculer, et vaincre. Loin d’eux, elles n’en avaient jamais été plus proches. Elles brûlaient de les servir, et, par eux, la patrie. Puisque la France n’était pas morte du premier coup, il fallait qu’elle vécût comme avant, plus qu’avant, plus intensément, et que la guerre fût entretenue par les travaux de la paix. La ferme abandonnée, la boutique désertée, les affaires interrompues, là s’offrait un second champ de bataille et d’honneur, les femmes françaises s’y jetèrent avec la même ferveur que le corps du général Foch aux marais de Saint-Gond. Leur enthousiasme civique a correspondu à l’élan militaire des hommes.
Les organisations féministes d’avant-guerre
Cette spontanéité magnifique du sentiment féminin devait trouver un premier appui et un guide dans les organisations féministes d’avant-guerre.
La France est peut-être le pays d’Europe où la situa lion de la femme a offert, jusqu’en 1914, le caractère le plus paradoxal. Il n’est pas de nation, en effet, où l’action féminine, depuis la cour des vieux rois, se voit exercée plus souverainement sur les mœurs, sur la littérature, sur les arts. La Française a régné par la beauté, par l’amour, par la mode. Nulle n’a été, depuis la sentimentalité chevaleresque jusqu’à la passion romantique, pareillement courtisée, chantée, adulée, ou même — comble de gloire — détestée et maudite. Notre civilisation nationale porte, comme nos industries de luxe, un caractère principalement féminin : de là sans doute son charme et son attirance. Par contre, il est peu de nations civilisées où la condition légale de la femme soit demeurée aussi indécise que chez nous. En 1789, la Révolution a déclaré les droits du citoyen : elle a négligé ceux de la citoyenne. La femme française, non seulement ne vote pas, mais elle ne signe pas : elle ne possède ni ses biens, ni ses enfants. Dans le mariage, elle reste une mineure, et, en dehors du mariage, elle est bien moins encore. Quand elle travaille, c’est au rabais. Nos lois sont en retard sur nos mœurs : de là l’existence du Féminisme, qui n’est point propre à notre pays, mais qui est chez nous plus ancien et plus doctrinaire, quoique moins retentissant qu’ailleurs, – chez les suffragettes anglaises, par exemple. Sans se lancer ici dans les questions probablement insolubles et en tout cas oiseuses, sur le mérite et les droits respectifs des deux sexes, on peut donc affirmer du moins la légitimité de tout féminisme dans la mesure où il réclame pour les femmes une condition légale qui corresponde davantage à leur influence morale.
Les principales organisations féministes françaises, dont quelques-unes comptaient leurs affiliées par centaines de mille, – Ligue française pour le droit des femmes, Egalité, Conseil national des femmes, Union française pour le suffrage des femmes (U. F. S. F.), Vie Féminine, – ne pouvaient manquer d’apercevoir aussitôt, dans la guerre, une occasion particulièrement favorable à leur but. Elles se mirent à l’œuvre. Leur patriotisme et leur doctrine coïncidaient. Leur sentiment et leurs principes s’accordaient. En servant la France, elles servaient leur cause.
Dans toutes les entreprises de travail et d’assistance, on trouvera leurs initiatrices ou leurs présidentes. Elles inspireront les pouvoirs publics et en recevront l’appui. Ainsi, le Conseil national des femmes françaises organise : l’Office de renseignements aux familles dispersées ; les Foyers du Soldat, le Foyer français (à Athènes), l’Office central de l’activité féminine. — A l’Union française pour le suffrage des femmes se rattachent : l’Aide fraternelle aux réfugiés et évacués alsaciens-lorrains, l’Union centrale des Œuvres du XVIe arrondissement. — La Ligue française pour le droit des femmes a fondé au début de la guerre onze ateliers-cantines que la reprise du travail a rendus heureusement inutiles. — L’Union fraternelle des femmes a organisé de remarquables conférences de propagande et d’instruction.
Le génie féminin et la préparation méthodique : La Croix-Rouge
Un jour peut-être les historiens de l’avenir raconteront les péripéties militaires et détailleront les campagnes de cette guerre : raconteront-ils jamais l’héroïque énergie et l’implacable endurance de nos soldats? Dans les drames où se jouent les destinées des nations comme dans les crises morales qui décident du sort des individus, le plus beau, on ne le voit pas, on ne le sait pas !… De même, on pourra bien décrire le rôle de la Croix-Rouge française, d’abord pour remplacer, ensuite pour assister le service sanitaire de nos armées : l’âme de l’infirmière, qui la dira telle quelle fut? Sur les cheveux bruns ou blonds, gris ou blancs, ces voiles familiers qui, durant tant d’années, auront flotté avec une persévérance monacale, qui saura les soulever, les soulever avec assez de respect et de pénétration? « Les soins calmants et réchauffants », comme dit le poète, l’infatigable tendresse d’un cœur universellement maternel, même ceux qui en ont bénéficié, qui lui ont dû plus que la vie, savent-ils bien de quelles sources ont coulé ces trésors de dévouement et d’organisation?
La femme, dont la rapide adaptation aux conditions de la guerre constituera l’un des étonnements de l’avenir, n’est pas, autant qu’on serait tenté de le croire et qu’on se risque à le dire, improvisatrice. Ce qu’elle fait le mieux, c’est ce qu’elle a appris à faire.
Le 7 octobre 1870, 160 jeunes filles ou femmes se présentaient sur la place de l’Hôtel de Ville et sollicitaient du Gouvernement provisoire l’autorisation d’aller dans les ambulances remplacer les hommes qu’on enverrait se battre. Beau geste que toutes ne purent soutenir, l’instruction technique ne répondant point à la bonne volonté : la Croix-Rouge française comprenant la « Société des Secours aux blessés militaires », l’« Union des Femmes de France », l’« Association des Dames françaises », est née pour préparer cette instruction spéciale et organiser cette bonne volonté spontanée.
Après avoir fait ses premières armes en Tunisie, à Madagascar, au Maroc, aux Balkans, la Croix-Rouge était parvenue, en 1914, au plein de sa maturité et de son développement : 250.000 adhérentes, 30 millions, 600 hôpitaux, 33.000 lits. Dès la mobilisation, la Croix-Rouge ajoute à ce matériel 500 châssis automobiles pour le transport rapide des blessés et loue près de 1.500 immeubles nouveaux, à Paris, sur les côtes de la Méditerranée et de l’Atlantique et l’oriflamme de Genève se déploie jusque dans les plus petites villes, au lycée, dans les écoles, les hôtels, les magasins.
A ce personnel de la Croix-Rouge, il faut ajouter 6.243 sœurs.
Ce n’était rien pourtant, que de telles ressources, devant une guerre où l’industrie avait mis en jeu toutes les forces de destruction. Mais sur cette base solide d’une préparation méthodique, le génie féminin put se développer librement : ce qui fut improvisé, c’est le dévouement, le dévouement qui toutes, au front, à l’arrière, dans les salles opératoires, dans les maisons de convalescence, dans les cantines, les lingeries, les pharmacies, toutes, de la vierge rougissante à l’aïeule vénérable, les enflammait d’un même zèle, d’une même tendresse, — la tendresse maternelle.
L’Infiltration féminine
La mobilisation n’avait pas seulement interrompu les paiements, mais la vie sociale entière. La guerre se prolongeant, il fallait que reprît, avec les paiements, le travail. Là, où manquaient les hommes, on essaya des femmes, d’abord timidement : la nécessité elle-même ne triompha pas d’un coup de préjugés séculaires et de défiances intéressées. La femme française s’insinua, s’infiltra. Rien ne ressemble moins à une conquête, que son triomphal avènement.
Elle s’est manifestée d’abord chez elle, dans sa ferme, dans sa boutique, dans son industrie, montrant peu à peu, à la place de son mari, ce dont elle était capable comme cultivatrice, comme marchande, comme patronne.
On connaît cette boulangère de Vau-Fresnay qui, pendant la bataille de la Marne, ralluma le fournil abandonné par son mari qui se battait, pour nourrir nos soldats en retraite et qui, aidée de sa vieille mère, nuit et jour, sans arrêt, tandis que le canon tonnait, fit du pain. « Le premier soir, brisée de fatigue, je pleurais dans un coin du fournil. Mais les malheureux défilaient toujours plus nombreux, arrachant du four les miches brûlantes, avant que la cuisson fût complète. » Une autre boulangère, une gamine de treize ans, avec son frère âgé de dix ans, a fait et vendu pendant des mois, à Exoudun, quatre cents kilogrammes de pain par jour. Un peu partout se sont improvisées des femmes charrons, menuisiers, maçons, couvreurs même : d’autres se sont mises à porter les fardeaux, à percevoir les impôts, à notarier les actes. Paris a été ravitaillé par ses maraîchères et toute la France par ses paysannes.
M. Viviani, Président du Conseil, en une proclamation véhémente, les avait appelées à la terre : elles ont répondu à cet appel comme les soldats à l’autre. Moisson, battage, arrachage des pommes de terre, soins aux animaux, traite des vaches, elles ont, toutes seules, assuré toute la besogne.
Parmi les fermières de la Brie, voici une femme de soixante ans qui laboure elle-même son champ pour ses deux fils et son gendre. Patronnes et « ouvrières agricoles » ont pareillement peiné et notre vaste plaine nourricière, la Beauce, a été un autre champ d’honneur, où les citations des femmes valent celles de leurs « hommes ». Mme L., à R., « a pris la direction d’un domaine de 130 hectares qui comprend un troupeau de 400 moutons et de 15 vaches, a su, en dépit de nombreuses difficultés et du manque de main-d’œuvre, faire face à tous les besoins et maintenir l’exploitation au point où l’avait laissée son mari ».
Mme M…, à Saint-L., « mère de cinq enfants, cultive une exploitation de 60 hectares : quoique d’une santé précaire, assume la direction d’un domaine dans lequel il y a 6 chevaux, 16 vaches, 4 porcs, de nombreux moutons et de nombreuses volailles : est intelligemment secondée par ses trois filles, surtout par sa fille aînée, qui, non contente de s’occuper de l’intérieur de la ferme, a l’œil partout, remplace un charretier, mène les voitures et va jusqu’à conduire une moissonneuse, munie de tracteur automobile ».
Ainsi la France a pu faire en hommes le plus large sacrifice qu’aucune nation ait jamais supportée : elle en a mobilisé des millions sans que sa vie nationale fût interrompue. La Française s’est mise à tout et partout.
Son succès fut rapide, parce que la besogne pressait. Alors, elle se hasarda à sortir de la maison, on se risqua à l’employer dans les fonctions publiques. Elle y devait réussir aussi bien que chez elle et précipiter le mouvement par ses résultats.
Dans l’enseignement, principalement dans l’enseignement primaire, on ne comptait pas moins de 30.000 mobilisés. Aujourd’hui plus de 12.000 femmes font la classe aux garçons.
Dans l’enseignement secondaire, la nécessité de grades plus élevés a restreint la féminisation des cours : on ne compte pourtant pas moins de 600 femmes dans les lycées de garçons où elles donnent pareillement satisfaction à leurs élèves, qui les respectent, et à leurs chefs, qui les admirent.
Dans l’Administration des P.T.T., 18.000 mobilisés ont été remplacés par 11.000 femmes. On a vu, dans certaines communes, jusqu’à des factrices rurales. Dans les grandes Compagnies de chemins de fer, 11.000 mobilisés sont suppléés par 6.500 femmes. Le Nord-Sud et le Métro emploient 1.000 ou 1.200 femmes et les tramways ne comptent plus guère que des femmes, même à la conduite des voitures. Enfin, il suffit d’avoir assisté à la sortie de certains grands établissements de crédit pour se rendre compte jusqu’à quel degré en ont été féminisés les services. « On n’a qu’à se louer, déclare un des directeurs, des résultats fournis par cet emploi des femmes dans les banques. Leur docilité, leur conscience sont exemplaires, et la sécurité est plus grande avec elles qu’avec le personnel masculin, les tentations de la grande ville étant pour elles moins nombreuses, moins dangereuses. ».
Sous Louis-Philippe, des féministes hardies réclamaient timidement des femmes dans les restaurants : on en a mis aujourd’hui jusque dans les wagons-restaurants !
Le salaire est, naturellement, fort inégal, mais toujours raisonnable et constituant pour la famille un substantiel appoint. Dans les tramways, la journée de onze heures est payée 5 francs. Dans les banques, on ne fournit que cinq à six heures de travail : la besogne est d’abord très simple et l’on débute à 3 francs; avec la titularisation, on s’élève à 5 et 6 francs.
Devant une pratique si étendue et si généralement satisfaisante, l’État ne pouvait, dans ses administrations, demeurer en retard sur les administrations particulières. Il a fait appel aux femmes, non seulement dans les ministères, mais dans les casernes. M. Henry Déranger (Journal officiel du 15 mai 1917) estime à 150.000 le nombre des employées de l’Administration de l’armée : c’était la victoire définitive. Le jour où le colonel d’un régiment de province a consenti à faire franchir la grille à des dactylographes et à des plantons en jupe, il a tué le dernier préjugé qui résistât encore à l’esprit nouveau. Ce préjugé n’est pas mort d’un coup, d’ailleurs : tous leschoix n’ont pas été également heureux, et le rendement du travail immédiat. Dans l’ensemble, il demeure prodigieux que la mise au point d’un régime si inattendu ait été si rapide. La seule critique que l’on puisse encore entendre, parfois, formuler contre l’emploi des femmes dans l’administration militaire par les derniers sceptiques, c’est qu’on ne peut pas aisément les faire surveiller par d’autres femmes. Elles-mêmes ne semblent pas, dans leur élévation, avoir perdu tout préjugé et elles gardent celui-ci, le plus ancien de leur histoire sociale : n’obéir qu’à l’homme. Pourquoi l’homme le leur reprocherait-il ?
L’organisation industrielle
Tant d’heureuses initiatives auraient-elles pourtant abouti aux résultats qui nous émerveillent aujourd’hui sans l’intervention de l’Etat et son impulsion organisatrice ?
C’est à l’usine de guerre que la Femme, en préparant la victoire du pays, a consacré la sienne.
La bataille de la Marne avait laissé le Gouvernement en présence d’un problème, industriel : la création du matériel de guerre. La mobilisation avait laissé l’industrie en présence d’un problème technique : la main-d’œuvre. Parmi les ouvriers primitivement mobilisés, on en rappela, afin de parer au plus pressé, quelques-uns. Mais ce ne pouvait être là qu’un expédient momentané : l’armée avait à sauvegarder ses effectifs et la conscience publique à observer la justice ; le commandement ne devait point consentir à renvoyer des soldats ni le Gouvernement à les embusquer. Dès qu’on les eut rappelés, on ne songea plus qu’à les remplacer. Ainsi s’explique toute la politique menée dans l’industrie de guerre ; double nécessité de produire au maximum et de respecter, pour tous les hommes, l’égalité devant le péril.
Au mois de janvier 1916, si l’on pénétrait dans une usine travaillant pour la défense nationale, on y trouvait une main-d’œuvre dont la composition se résumait à peu près uniformément dans la statistique suivante :
100 ouvriers comprenaient :
– 50 civils ayant, pour raison d’âge ou de santé, satisfait à toutes leurs obligations militaires et travaillant aux mêmes conditions qu’en temps de paix ;
– 40 mobilisés à des titres divers ;
– 10 femmes.
Six mois après, on trouvait toujours la même proportion de civils, mais le second demi-cent se décomposait ainsi :
– 24 hommes ;
– 26 femmes.
Cette rapide progression de la main-d’œuvre féminine dans les usines de guerre, voulue et encouragée par les pouvoirs publics, se trouvait encore facilitée par la crise des industries, presque toutes de luxe, où les femmes étaient employées pendant la paix. En même temps qu’on cherchait des ouvrières d’un côté, s’offraient de l’autre des chômeuses. L’armée réclamait des travailleurs et les femmes du travail : il s’agissait simplement de diriger l’offre de la main-d’œuvre vers la demande industrielle et la difficulté se réduisait à une question de placement. Il fallait organiser l’embauchage et. d’une manière générale, rendre possibles, puis régulières, les relations des employeurs et des employées, problème d’autant plus urgent et plus délicat que l’ouvrière était une néophyte, ayant également besoin d’être instruite et d’être protégée.
La déclaration des droits économiques de la femme
Conformément à ces nécessités, le Sous-secrétariat des Munitions, en même temps qu’il intensifiait la campagne de l’embauchage féminin dans les usines de guerre, prenait les mesures ou créait les institutions dont l’ensemble compose, en quelque sorte, la charte économique de l’ouvrière française.
Le 22 mai, puis le 10 juillet 1915 étaient votées des lois qui mettaient un terme à l’abus séculaire de l’exploitation de l’ouvrière a domicile.
Les débuts de la guerre, en effet, n’avaient fait qu’aggraver ces mœurs invétérées. Les brusques besoins de l’Intendance avaient multiplié les intermédiaires, les sous-traitants, et tout le poids de cette échelle de trafiqueurs reposait sur la travailleuse isolée.
Dès 1914. se constituait « une société coopérative pour défendre les ouvrières contre les sous-traitants de l’Intendance ». Nul syndicat ne protégeait ces malheureuses, et l’on découvrit jusque dans des ouvroirs, qui se donnaient pour des œuvres de bienfaisance et se faisaient subventionner par l’État, des salaires scandaleux. Par un mécanisme assez compliqué, mais raisonnable, les lois nouvelles mettaient fin à ces pratiques : un minimum de salaire était fixé.
Au mois d’octobre de la même année, tandis que le Ministère du Travail développait ses offices départementaux, un Office de placement était créé et il est impossible de résumer ici la suite des circulaires et des arrêtés par lesquels le Gouvernement, tout en poussant de plus en plus les femmes dans les usines, s’efforçait de les protéger contre les risques d’une situation si nouvelle.
Qu’on se représente, en effet, non plus par la théorie ou le cinéma, mais dans sa réalité pathétique et brutale. le tableau d’une de ces immenses usines où, à l’appel de la sirène, s’engouffrent ces ouvrières improvisées. Du feu, de la fumée, le métal en fusion, une atmosphère brumeuse et frémissante, le tumulte assourdissant des tours. Là, au milieu des courroies en mouvement, elles sont toutes debout, vêtues de noir, parfois de cuir, les cheveux serrés sous le bonnet de baigneuse, le corps puissant sous l’ajustage de la blouse : la machine ne leur laisse nul loisir. Elles ont des gestes, rapides et sûrs, qui semblent lents et doux. Malgré la blancheur d’un bras qui parfois apparaît sous la manche relevée ou la grâce d’une frisette qui échappe du bonnet, jeunes et souples, elles expriment la force, l’ordre, l’implacable volonté humaine façonnant la matière. Elles ne distinguent pas, non plus que l’horaire, le jour de la nuit. Quand vient l’heure trouble de l’aube, leurs yeux se creusent et brillent : « La femme fatigue ! » dit un contremaître. Elle « fatigue », mais ne se décourage pas ; plus elle travaille, plus elle a de « rendement », et ce n’est pas seulement l’appât du gain qui l’attache à son tour. Elle l’aime comme une arme, comme un engin de guerre. Or, ces sombres et rudes combattantes, d’où viennent -elles? Dans la région lyonnaise, sur 2.000 femmes employées par une usine de guerre, on a compté 400 culottières, 400 femmes de ménage, 200 giletières, 150 couturières, 150 lingères, 4 artistes. A la Pyrotechnie de Saint-Chamond, 2.000 femmes du pays se sont enrôlées, qui n’avaient jamais manié que l’aiguille ou le balai et l’on n’a pas oublié les doléances de toute la bourgeoisie qui ne peut plus recruter de bonnes. — « Madame, je m’en vais aux munitions ! »
C’est pour présider à cette évolution délicate que fut constitué, le 22 août 1916. le Comité du travail féminin dans lequel figurèrent, avec tous les partis, toutes les compétences et autorités masculines ou féminines, et qui s’attache particulièrement aux questions touchant le salaire et l’hygiène de l’ouvrière.
Les résultats
Le résultat d’un effort si méthodique et vivifiant ne se fit guère attendre et il suffit de quelques chiffres pour en mesurer la portée et l’efficacité.
Au milieu de 1915, 15.000 femmes travaillaient dans les usines de guerre.
Fin janvier 1916, 100.000.
Fin juin 1916, 204.000.
Fin décembre 1916, 300.000.
Fin mai 1917, 684.000.
Certains établissements sont de véritables cités, où les travailleuses se comptent par dizaines de mille. Dans la région parisienne, elles ont pu, tout en allant à l’usine le jour ou la nuit, continuer de demeurer chez: elles : deux fois par jour, elles en sont quittes pour une heure et parfois plus, de transport en métropolitain ou en tramway. Mais dans les grandes installations nationales, dans les poudrières notamment, il en est venu de toutes les régions de France, et la ville la plus proche est trop éloignée pour qu’on y puisse habiter : pour deux francs par jour, ces femmes sont logées et nourries dans des cantonnements où ont été prises toutes les mesures de confort et de salubrité, presque d’élégance. Ainsi sont nées, dans des terrains vagues, d’étranges villes de bois, où chaque baraquement évoque, non pas la guerre, mais les longs voyages en paquebot.
Si l’on ajoute à ces usines de la défense nationale, toutes les femmes employées dans les administrations et divers métiers auxquels nous avons fait précédemment allusion, on arrive à un total voisin d’un million et demi.
Voilà pour le fait.
Le principe est plus important encore.
Les pouvoirs publics, en effet, attestant ainsi le bienfait dans toute organisation sociale d’une intervention résolue de l’État, sont parvenus, grâce à des efforts répétés, à faire triompher l’une des revendications essentielles du Féminisme, l’égalité des sexes devant le salaire.
Sans cesse, il a été rappelé aux employeurs travaillant pour la défense nationale et utilisant la main-d’œuvre féminine que le principe qui domine toute la question est le suivant : « lorsque des ouvrières effectuent réellement le même rendement qu’un ouvrier, elles doivent être rémunérées au même taux que tes hommes employés aux mêmes travaux. »
Ainsi l’usine de guerre ne faisait plus acception d’homme ni de femme : elle considérait l’ouvrage, non l’ouvrière ; à la caisse, on ne connaissait plus que des travailleurs, indépendamment de la jupe ou du pantalon.
L’avènement économique de la femme était accompli. La loi de 1907 lui avait assuré la libre disposition de son salaire : le régime nouveau en assurait l’intégrité. L’ouvrière égalait l’ouvrier. Elle pouvait gagner, en moyenne, 5, 7 francs par jour et même, dans certaines spécialités, jusqu’à 10 et 12 francs. Le travail, après l’avoir ennoblie, la nourrissait aussi. Elle avait vaincu, par la guerre, les derniers préjugés.
Conséquences techniques et sociales
La guerre endurcit les mœurs. Les longues périodes de guerre préparent ainsi à la femme un rôle civilisateur. Dans toute notre histoire, la Française n’a jamais failli à cette mission délicate. Dans les ténèbres du moyen âge, au XIIe siècle, dans l’enfantement douloureux du monde moderne, au XVIe siècle, la femme a été l’initiatrice de la paix et de ses travaux.
Dans !a décomposition du vieux inonde que la guerre aura consommée, il en sera de même aujourd’hui.
La femme aura contribué de tout son cœur et avec toutes ses forces à la défense, à la gloire de la patrie : sa tâche sera plus impérieuse encore pour assurer à la France, dans la lutte économique, la place qu’aura méritée cette gloire.
L’armée des ouvrières, on ne la démobilisera pas ; on s’appliquera, au contraire, à la garder. La France victorieuse aura besoin d’une main-d’œuvre accrue. Que les vainqueurs, au retour des tranchées, ne craignent point de voir leurs places prises. Sans doute les femmes ne s’obstineront-elles pas à conduire des tramways ou à porter des colis. Il y aura du travail pour tout le monde, de l’argent à gagner pour les deux sexes. Que l’expérience de la guerre serve seulement à la paix ! La collectivité, qui aura appris ce que valent les ouvrières, les ouvrières, qui auront appris ce que vaut l’ouvrage, ne l’oublieront plus.
La France, depuis longtemps, à cause de la faiblesse de sa natalité, d’une part, et d’autre part, à cause du caractère luxueux de ses principales industries, se trouvait la nation d’Europe qui faisait le plus large appel à la main-d’œuvre féminine. Ce mouvement tendait naturellement à s’accroître. Il a reçu de la guerre une impulsion irrésistible. Il ne s’arrêtera plus.
Nous avons déjà fait allusion à la Commission industrielle américaine, qui a visité, en 1916, toutes nos usines : elle a beaucoup admiré l’installation des plus modernes. Un caractère pourtant l’a frappée, caractère par lequel notre usinage s’oppose à l’usinage américain : nous n’y faisons pas assez de place à la machine et laissons à des ouvriers une besogne qu’une mécanique exécuterait mieux qu’eux : il y a une déperdition d’énergie humaine. En Amérique, presque tout le travail se fait de lui-même : l’ouvrier surveille. La perfection de l’outillage économise sa peine. C’est à cause de cette déperdition de force humaine qu’a si longtemps subsisté chez nous la croyance que la femme était physiquement trop faible pour certains travaux. Pour compenser cette faiblesse, il a donc fallu s’ingénier à trouver des dispositifs nouveaux qui rendissent le travail de l’ouvrière plus facile et moins fatigant. En principe, les femmes ne sont employées dans la fabrication que pour les obus de 75 et de 120. Mais, dans certains établissements de l’État, il existe un tour spécial, système Popin, pour les gros calibres, jusqu’au 320, et qui peut être conduit par des femmes. Dans une autre usine, les obus de 270, dont le poids est d’environ 112 kilogrammes, sont manipulés par des femmes, grâce à la perfection de l’outillage. Une importante société de métallurgie a même résolu le problème d’étendre la main-d’oeuvre féminine à l’emboutissage et au tréfilage des obus de 220 en acier, comme cela fut fait progressivement pour le 75 et le 105. Ainsi se trouve justifiée cette conclusion de la Commission américaine dont le témoignage prendra pour les femmes françaises une autorité si flatteuse :
| « La Commission a pu étudier à Paris un moyen instructif et impressionnant de remédier à la situation de la main-d’œuvre, en employant le travail féminin pour les besoins nationaux les plus pressants, ce qui a été exécuté à un degré que l’on aurait cru impossible. Les femmes de France ont répondu aux nécessités de l’heure avec un magnifique patriotisme, elles se sont adaptées rapidement à des tâches nouvelles, avec un efficacité qui renversa les vieilles théories et donna naissance à des innovations qui seront profitables à l’industrie dans l’avenir. Les méthodes inventées pour compenser la faiblesse physique relative des femmes ont remarquablement accéléré l’exécution et réalisé une production en rapport avec les besoins urgents de la nation. L’industrie française sortira grandie de l’épreuve. »
Retenons surtout, de ce beau compliment, une espérance.
L’Organisation de l’embauchage
Lorsqu’on parcourt l’ensemble des circulaires par lesquelles le Sous-secrétaire des Munitions et le Ministre de l’Armement n’ont cessé de pousser les industriels français à l’emploi intensif de la main-d’œuvre féminine, on s’aperçoit que l’une des plus grandes difficultés qui durent être vaincues fut le recrutement même de cette main-d’œuvre. Dans certaines régions, trop d’offre et pas assez de demande ; dans d’autres, trop de demande et pas assez d’offre. L’Administration s’appliqua à remédier à cet état de choses en centralisant tous les renseignements de manière à diriger elle-même cette main-d’œuvre féminine, comme des troupes, sur les points du territoire où il en était besoin. Cette méthode réussit : elle laissait place, pourtant, à beaucoup d’imprévu et n’alla point sans quelque hasard ni déchet. De là l’intervention de l’initiative privée et la création d’œuvres destinées à régulariser cet enrôlement des Françaises dans le présent et dans l’avenir.
Vers le mois de novembre 1916, en effet, toute Française, habituée à travailler, « qui savait ce qu’elle voulait » pouvait se faire inscrire sur une fiche de travail et réaliser son dessein. Mais, parmi les femmes de bonne volonté, beaucoup désiraient travailler sans savoir à quoi au juste. C’est à l’usage de ces vocations incertaines que fut constituée l’Association pour l’enrôlement volontaire des Françaises au service de la Patrie. Sa première tâche fut un recensement, sa seconde, un enseignement : recruter les ouvrières et leur apprendre leur ouvrage. La première opération assurait la moralité, la seconde, la capacité des enrôlées, et l’ensemble constituait un service de placement qu’encouragèrent les pouvoirs publics et auxquels ils recoururent.
Une telle œuvre, à laquelle se sont vouées de grandes Françaises, survivra et se développera. Se plaçant au point de vue de la « nation qui a besoin de travailleuses et non pas au point de vue des femmes qui ont besoin de travailler », elle se propose comme but « l’amélioration de la qualité du personnel féminin ». Une mobilisation si rapide, il faut bien le reconnaître, a mêlé le bon et le mauvais dans les usines, et même dans les bureaux. L’ensemble de la moralité n’est pas toujours très élevé. On a vu des malheureuses, victimes de la guerre, instruites, de moyenne et de haute bourgeoisie, s’inscrire pour des emplois de filles de salle, d’usinières, de laveuses de vaisselle. Elles ployaient sous la nécessité et se fussent perdues sans un secours.
Telle sera la tâche de demain : régulariser le recrutement improvisé des femmes, en assurer la moralité, en faciliter la préparation. Telle devra être la méthode : des enquêtes des cours d’apprentissage, des examens techniques. Déjà on a vu naître un Institut agricole pour les orphelines, une École de hautes études commerciales pour les jeunes filles de la bourgeoisie, une autre sous le patronage de la Chambre de commerce de Paris, une École de gouvernantes, une École centrale de puériculture, une Ecole technique pour des femmes ingénieurs ou architectes.
La mère ouvrière
Quand on écrira l’histoire de la femme française au travail, il faudra faire une place particulière au problème que cette nouveauté a posé dès la première heure, — problème vital pour un pays comme le notre, dont la natalité est si faible, dont les sacrifices ont été si grands : la maternité ouvrière. Ne semble-t-il pas y avoir, en effet, une incompatibilité nécessaire entre la maternité et le travail, entre les nécessités de la grossesse ou de l’allaitement et les exigences, les fatigues de l’atelier ? Comment concilier ces contraires ?
Comment ne pas séparer, à l’usine, ce que la nature a joint, le groupe sacré de la mère et de l’enfant?
La France, qui a tant besoin d’enfants, avait été très lente à protéger les mères : par la loi de 1893, on s’était enfin décidé, assimilant l’accouchée à une malade, à lui assurer le bienfait de l’assistance médicale; vingt ans après seulement, en 1913, paraissait la loi sur le repos des femmes en couches. C’était tout, et la question, comme on voit, restait entière: c’est à la résoudre enfin et à en imposer la solution que le Comité du travail féminin a consacré une partie de son activité si féconde.
Sur les rapports des médecins, qui en sont membres, notamment du Dr Lesage, médecin des hôpitaux, il a émis des vœux dont se sont aussitôt inspirées les circulaires ministérielles, — celles du 10 août 1916, relatives au contrôle des crèches des Établissements de l’Etat par les Services de la protection des enfants du premier âge ; celle du 4 janvier relative à la protection de la maternité ouvrière dans les usines de guerre, réclamant pour les femmes en état de grossesse un travail moins pénible, sans que les mesures prises pour alléger et abréger ce travail entraînent aucune réduction ou suppression de salaire; celle du 1er mai 1917 sur les majorations de salaire destinées à encourager l’allaitement maternel : le tout aboutissant enfin à la loi du 5 août 1917, concernant l’allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux.
entièrement nouvelles, inspirées de principes, non seulement de justice, mais d’hygiène et de puériculture. La mère était protégée dans son droit au travail, l’enfant dans son droit à la vie : à l’un on assurait son salaire, à l’autre son lait ! La charte de la mère suivait celle de l’ouvrière. Dans l’usine même où elle travaillait, elle trouvait, dès sa grossesse, des égards et du repos ; durant ses couches, un congé ; après ses couches, une chambre d’allaitement pour y déposer et y nourrir son bébé ; quand il était sevré, une crèche ; et quand il avait deux ou trois ans, une garderie. Elle était sûre, durant qu’elle était à l’ouvrage, qu’on s’occupait de lui, qu’on lui réservait de l’air pur, de la propreté, du confortable, qu’on le tenait à l’abri des épidémies et que sa maternité, loin d’être un charge, devenait ainsi pour elle un repos, une distraction et un avantage.
On se rendra compte du point de perfection où l’on est parvenu à cet égard, en allant à Levallois-Perret, au 93 de la rue Danton, où, sur les plans mêmes du médecin, avec l’aide de l’État, les patrons réunis ont installe une garderie modèle pour les enfants de leurs ouvrières. Au milieu même des usines et des maisons tristes, on dirait un palais de Liliput : des toits bas, des fenêtres éclairées, de petites pelouses : 4 salles, abritant chacune 25 enfants, du ripolin, de l’aluminium, une salle de bain et des joujoux. Quand il fait beau, on ouvre les portes et les fenêtres ; les pelouses entrent dans la maison. Le jour de l’inauguration par l’ancien et le nouveau Ministre de l’Armement (rien que deux Ministres, s’il vous plaît, pour ces gosses !) l’un d’eux dit « On va leur inspirer le goût du luxe. » « Tant mieux ! » répondit l’autre, qui savait que la sagesse sociale est de rendre la vie, non seulement hygiénique, mais attrayante et gaie.
Conséquences législatives
De 1900 à 1914. les femmes avaient gagné successivement le droit de suffrage et l’éligibilité dans diverses assemblées : en 1910, dans les Conseils du Travail, des Prud’hommes; en 1908 pour les Chambres de commerce et Chambres consultatives des Arts et Manufactures. Dans le domaine de la Prévoyance, au Conseil de la Mutualité, les sociétés de secours mutuels, exclusivement composées de femmes, sont autorisées.
L’avènement économique de la femme, pendant la guerre, portera certainement des conséquences politiques. Déjà, en date du 1 5 février 1917, la Commission du Suffrage universel s’était prononcée en faveur de l’admission des femmes au droit de vote pour les élections municipales et de leur éligibilité aux Conseils municipaux. Nous avons vu, en effet, depuis trois ans, assez de jeunes institutrices, devenues secrétaires de mairie, administrer à elles seules, et parfois malgré la résistance de municipalités routinières et timorées, des communes importantes.
Des projets sont à l’étude pour les élections législatives.
Mais la légalité a déjà enregistré ces premières conquêtes de la guerre.
La loi du mois de février 1917, s’inspirant des circonstances où tant de femmes ont eu à supporter réellement les responsabilités de chefs de famille, permet à la femme d’être institutrice d’un autre enfant que le sien : c’est la fin de sa séculaire « incapacité », Lorsqu’elle est mariée, il lui reste seulement à obtenir l’autorisation de son mari.
Enfin, pour achever l’œuvre de la loi de 1907, assurant à la femme la libre disposition de son salaire, la Chambre et le Sénat votaient à l’unanimité la loi du 10 juillet 1915, à laquelle nous avons déjà fait allusion, fixant un minimum de salaire pour les femmes- travaillant à domicile.
Si l’on ajoute à ces lois, qui ont si profondément modifié la condition de la femme française, toutes les mesures dont nous avons parlé pour la protection de la mère et de son enfant, on se rend compte de l’immense chemin parcouru et d’un élan qui ne s’arrêtera plus.
La civilisation nouvelle
Est-ce une ère nouvelle de la civilisation que la femme française aura ouverte en se mettant au travail ?
Toutes les transformations profondes de l’humanité semblent avoir commencé par des causes économiques et s’être achevées par des effets moraux.
La guerre, par les nécessités de la main-d’œuvre et l’urgence de la défense nationale, a offert à l’activité féminine une occasion extraordinaire de se manifester ; cette expérience a réussi et la femme est désormais entrée dans la vie économique de la nation : elle y tiendra, sans doute, un rôle de plus en plus important.
Quelles seront les conséquences morales de cette évolution matérielle? On avait jusque là, dans notre civilisation occidentale, considéré la femme principalement comme une amoureuse ou comme une mère et l’on opposait volontiers l’une à l’autre. Nous avons vu l’effort de la nation pour que le travail de l’ouvrière ne nuise pas à sa maternité : ce n’est donc point la mère qui risque de se trouver sacrifiée dans le nouvel état de choses ; espérons que ce sera plutôt l’amoureuse et que, dans un pays où la femme aura conquis de haute lutte sa dignité économique et civique, on cessera de ne lui parler que de bagatelle. Si l’essence de toute culture est la conception du rapport entre les sexes, comment la nôtre ne se trouverait-elle pas influencée du jour où l’on ne considérera plus la femme uniquement comme une femme, mais où on la placera dans la vie sociale au même titre que l’homme? – Déjà, dans les bureaux et les usines, ne voit-on pas nos poilus, comme les guerriers d’Henri IV, s’affiner et se polir avec leurs nouvelles camarades ?
Quelques Œuvres créées par l’activité féminine avant et pendant la guerre.
Société de secours aux blessés militaires. — 1866.
Union des Femmes de France. — 1882.
Association des Dames françaises. — 1883.
La Ligue fraternelle des Enfants de France.
Ligue des Boulangères. — Octobre 1915.
Cantine du Bourget, près d’Aubervilliers. — Août 1914.
Pouponnière de la « Liberté ». — Août 1914.
Cocarde du souvenir.
L’Atelier du blessé.
La Mutualité maternelle.
Œuvres de la Croix-Verte (cinq formations chirurgicales automobiles).
Ligue nouvelle pour la protection des veuves et des orphelins de la guerre.
La Goutte de café.
Organisation complète d’hôpitaux auxiliaires (n° 69).
L’Aide aux femmes de combattants. — 10 août 1914.
La Francia — 1914.
L’Œuvre pour les hôpitaux militaires.
Bureau de secours aux réformés n° 2 des régions envahies.
L’Aide immédiate aux invalides et réformés de la guerre — 1914.
Union centrale des Œuvres d’assistance.
Office central d’assistance maternelle.
Ouvroir Paul Déroulède.
Orphelins de la guerre.
Ligue patriotique des Françaises.
Comité du travail féminin. — 2l août 1916.
Office centra! de l’activité féminine. — Octobre 1916.
Enrôlement volontaire des Françaises.
Le Conseil national des femmes françaises a organisé :
Office de renseignement aux familles dispersées.
Les Foyers du soldat.
Le Foyer français (à Athènes).
L’Office central de l’activité féminine.
Bulletin mensuel : L’Action féminine.
Se rattachent à l’Union française pour le suffrage des femmes. — 1909 :
L’Aide fraternelle aux réfugiés et évacués alsaciens-lorrains
L’Union centrale des Œuvres du XVIe arrondissement de Paris.
L’Œuvre parisienne pour le logement des réfugiés.
La Ligue française pour le droit des femmes (1878) a fondé au début de !a guerre 11 ateliers-cantines, que la reprise du travail a rendus heureusement inutiles. Deux ou trois existent encore actuellement.
Union fraternelle des femmes (Conférences).
Société coopérative pour défendre les ouvrières contre l’exploitation des sous-traitants de l’Intendance. — 1914.
Le Vêtement du Blessé. — 1915.
Les Maisons claires.
————————————————————————-
Gaston Rageot, La Française dans la Guerre, Paris/Neuchatel, Attinger Frères, 191? [1917 ou 1918], 32 p.